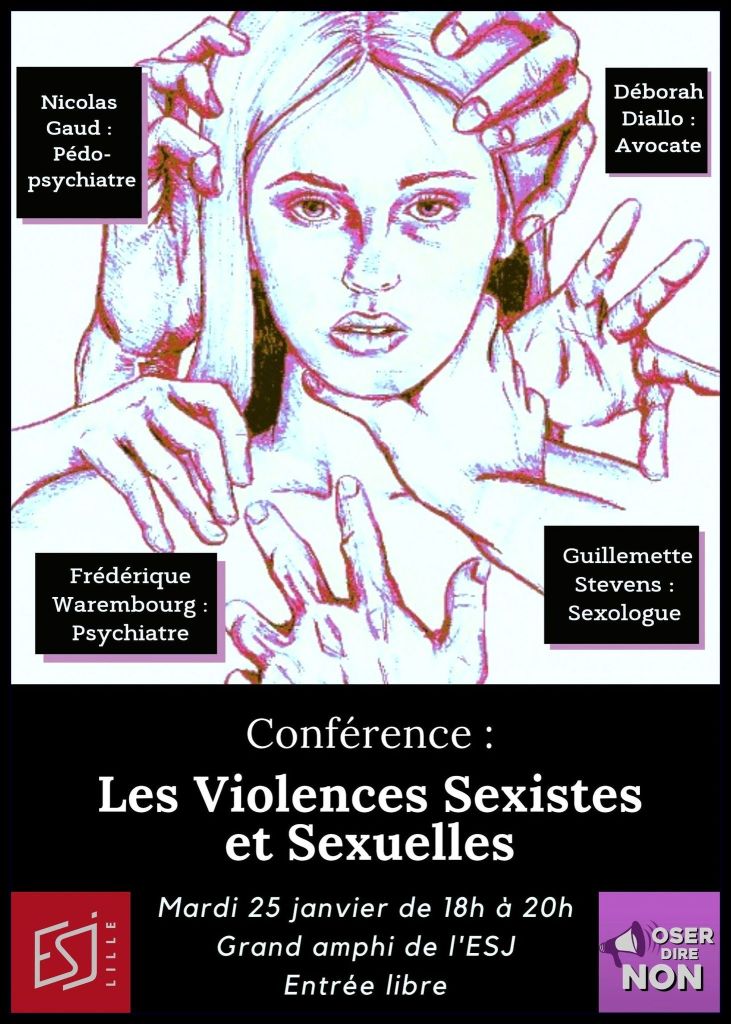Véritable accro de la musique, Gingerella enflamme le dancefloor derrière ses platines. Petit à petit, elle fait redécouvrir les classiques des années 60 et redynamise le milieu rétro.
Bottes en vinyle, jupe bien taillée, traits d’eyeliner sur les paupières et 45 tours à la main, Maureen aka Gingerella met le feu au Joe Tex Café. À la voir, on penserait qu’elle fait cela depuis des années – pourtant, son premier set n’était qu’à l’automne 2022.
Maureen a 26 ans, et est originaire de Reims. Son enfance a été bercée par la musique et les concerts, passion qui lui a été transmise par son père. “J’ai toujours voulu être une artiste. J’ai même joué de la flûte à bec pendant 7 ans, et j’étais super forte! Mais ce n’était pas très rock n’ roll comme instrument.” Avec le temps, les sous-cultures, et surtout celles des années 60, font partie intégrante de ses centres d’intérêt.

Naturellement, c’est vers la mode qu’elle se tourne pour faire carrière. “Je suis d’abord passé par un BTS design de mode, à Tours; puis, BTS modélisme à Tourcoing, pour enfin partir en formation professionnelle à Paris, dans le tailleur homme.”
La crise sanitaire est vite arrivée pour tout bousculer. Maureen a décidé de changer de voie, et s’est lancée dans la maroquinerie: “J’ai voulu revenir vers la matière, et m’éloigner de l’apparat.”
Le COVID n’a hélas pas perturbé que sa vie professionnelle. Comme beaucoup d’autres, le confinement l’a faite “crouler mentalement”. Plus de sorties, plus de concerts, plus d’opportunités d’aller danser et s’amuser entre amis… Tout était suspendu, et la fin des confinements n’a pas marqué le renouveau de la scène locale. “J’avais besoin de danser. Alors, je me suis dit que si personne ne relançait la machine, j’allais le faire.”
Maureen a donc commencé à contacter des bars, des groupes, afin d’organiser concerts et évènements musicaux à Lille. Quant à son activité de DJ, c’est un peu par hasard qu’elle s’est lancée.
“Ça a commencé au Joe Tex Café, quand le patron me demandait de passer quelques disques le temps qu’il s’occupe de clients. Puis, j’ai commencé à acheter des 45 tours, sans même penser à faire du DJ. Au final, mon premier set était assez improvisé, mais ça a vraiment plu aux gens” se rappelle-t-elle en souriant. “J’ai eu beaucoup de compliments et d’encouragements, donc j’ai continué !”
Ainsi est née Gingerella, son alter ego, son “médicament”: une version d’elle-même plus glam, plus affirmée, plus féminine aussi. Adopter cette identité de DJ signifie non seulement une opportunité de se redécouvrir en tant que femme, mais aussi de proposer au public “un vrai spectacle, à la fois visuel et sonore”.
Comme pour tous ses projets, Maureen y met toute son énergie, même si tout cela est allé bien plus vite qu’elle ne l’espérait.
Elle a déjà mixé de nombreuses fois au Joe Tex Café (Lille), aux Vieux de la Vieille (Reims), et plus récemment à la Mécanique Ondulatoire à Paris.


D’ailleurs, pour préparer un seul DJ set, il lui faut au moins l’équivalent de 4 à 5 heures de musique, soit une petite centaine de disques dans sa valise.
Cependant, les ambitions de Maureen sont assez simples: “Moi, je veux juste être cette DJ qui va te faire danser, où tu n’auras pas un moment pour poser ton cul ou t’ennuyer. Je veux voir les gens s’amuser et se rencontrer.”
Elle évoque l’idée d’aller chercher un autre public, un peu partout en Europe, et même dans les EHPAD – projet qui lui tient à cœur.
Évidemment, la consécration serait Londres, berceau de nombreuses légendes du rock.
“J’ai envie de faire ce qui me plaît, quand ça me plaît, et enfin oser” conclut-elle avec fierté. “J’ai osé me présenter, aller voir les bars, demander si je pouvais venir mixer: et ça, je n’aurais jamais eu le culot de le faire il y a encore quelques temps.”
– Lena Berquier